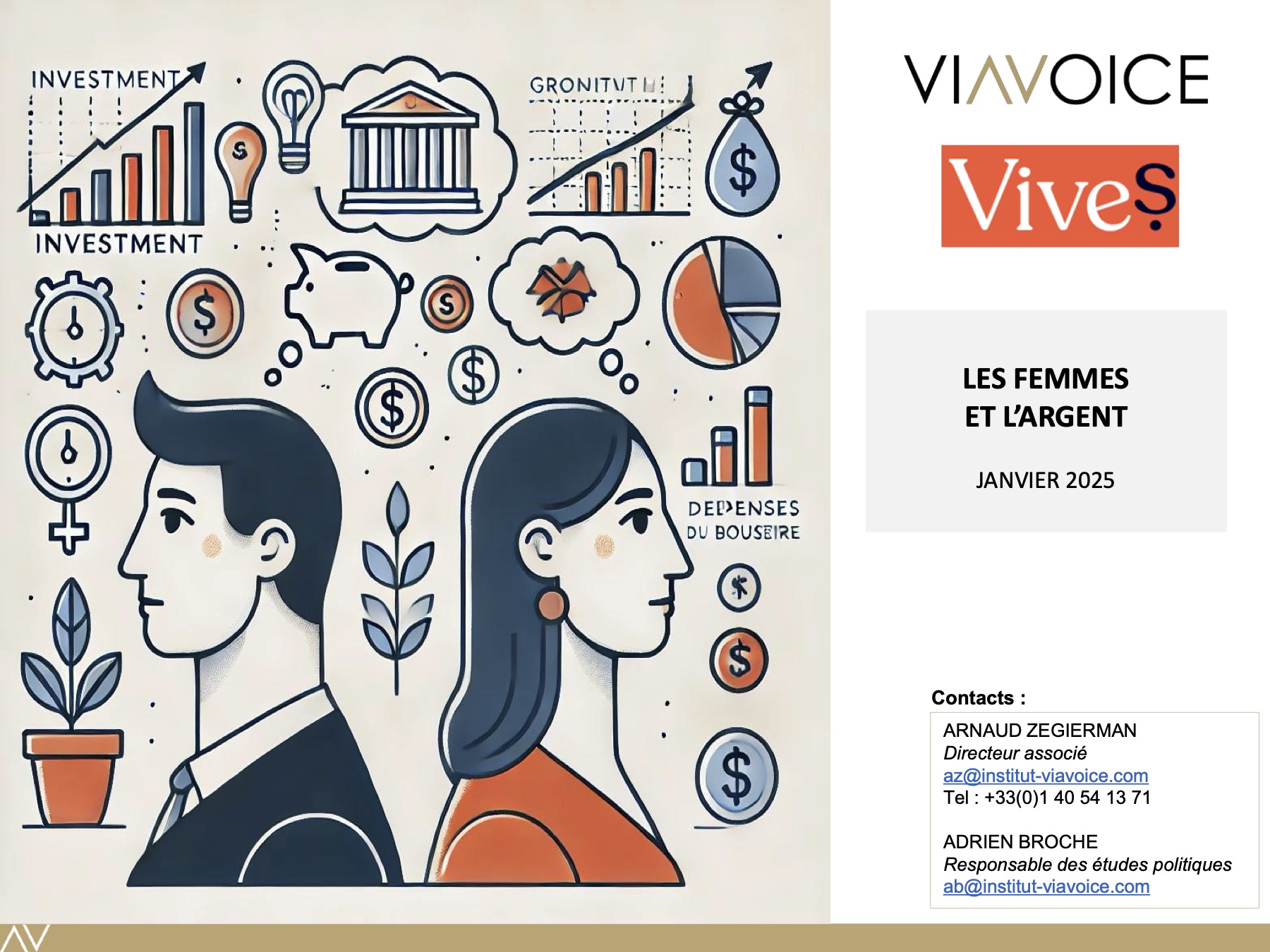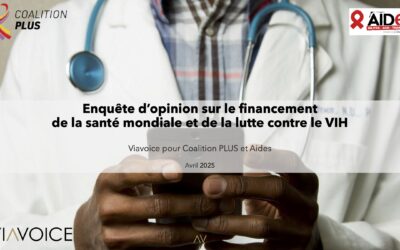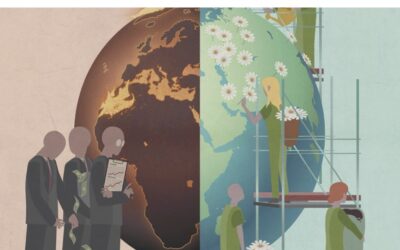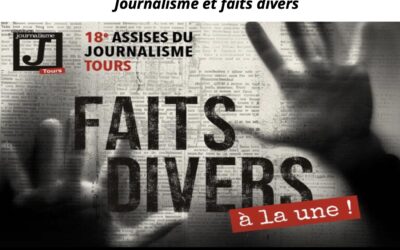L’argent reste un sujet délicat pour plus d’1 Français sur 2 (55%), un score sans lourde différence entre les hommes et les femmes : c’est davantage sur la relation à l’argent, sur la manière de l’aborder et sur les contextes d’évocation que les différences apparaissent.
1 . L’argent : davantage synonyme d’angoisse pour les femmes et de liberté pour les hommes
Pour les femmes, l’argent est d’abord associé à l’angoisse là où il est prioritairement synonyme de liberté pour les hommes. Les écarts concernant ces critères sont massifs : 9 points séparent les perceptions des hommes et des femmes sur la liberté et cet écart est de 12 points concernant les angoisses associées. Cette différence de perception ne peut être uniquement imputée à une différence d’éducation envers l’argent, puisque hommes et femmes déclarent de manière majoritaire et homogène avoir été sensibilisés dans leur famille à l’importance de l’épargne, à la gestion d’un budget et à l’intérêt de bien gagner sa vie. Une sensibilisation particulièrement forte auprès des 18-24 ans.
2 . Un imaginaire qui évolue au gré des générations
Une tranche d’âge charnière chez les femmes : les 25-34 ans. Cet âge marque une rupture entre la jeunesse et les responsabilités du monde adulte :
- 46 % des répondantes de cette tranche d’âge associent l’argent à un sentiment d’angoisse contre seulement 22 % à la liberté.
- D’ailleurs, seules 59 % des femmes de cette tranche d’âge estiment bien gérer leur argent (contre 79 % des hommes).
- Ce doute est confirmé par une moindre familiarité avec les éléments financiers pour cette tranche d’âge, puisque 78 % des femmes de 25-34 ans connaissent leurs rentrées et dépenses mensuelles (respectivement -15 pts et – 7pts par rapport à la moyenne féminine).
3 . Deux visions parallèles : l’imaginaire masculin qui repose sur l’investissement et l’ambition. Et l’imaginaire féminin qui repose de son côté sur la réalité, le quotidien et la famille
Le rapport que les femmes ont à l’argent s’apparente davantage à un rapport du quotidien : elles parlent autant de salaire que les hommes, mais beaucoup moins de patrimoine, de crédits et d’épargne. Ce qui touche au long-terme, à l’avenir, aux investissements, apparaît plutôt masculin.
Si les jeunes générations sont plus enclines à parler de ces thèmes, l’écart hommes-femmes se creuse chez les moins de 35 ans lorsque les conversations touchent au patrimoine et aux crédits, tandis qu’il s’amenuise à propos de l’épargne.
4 . Les femmes sont sur la défensive sur les questions liées à la vie professionnelle
Elles se montrent systématiquement moins à l’aise que les hommes s’agissant des questions d’argent dans l’entreprise. L’écart/gender gap est particulièrement vertigineux pour l’obtention d’une promotion (-10), pour demander une augmentation salariale (-17) et pour négocier un salaire pendant un entretien d’embauche (-21).
Cet embarras plus typiquement féminin est relativement stable au fil des générations, avec une propension plus marquée de la part des jeunes à changer d’entreprise pour gagner plus ou obtenir une promotion.
5 . L’étude percute certaines idées reçues :
Les femmes déclarent davantage que les hommes que l’argent était un sujet évoqué dans leurs familles lorsqu’elles étaient enfants, en particulier auprès des CSP+.
Les femmes ont davantage reçu de conseils en gestion financière de leurs parents (+6), en particulier chez les moins de 35 ans avec un écart flagrant de 14 pts chez les 18-24 ans (81% femmes, 67% hommes).Elles déclarent cependant moins recevoir de conseils de leur banquier ou conseiller en patrimoine (- 6), sauf chez les très jeunes (+9).
Davantage de femmes déclarent recevoir des conseils de la part de leur conjoint (+4), à l’exception des 25- 34 ans où 48 % des hommes déclarent recevoir des conseils de leur conjointe (+11 par rapport aux femmes). Les femmes parlent davantage d’argent avec leurs enfants ou leurs parents que ne le font les hommes (+4 et +6) mais nettement moins qu’eux avec les collègues (-5).
La persistance d’autres idées reçues peut étonner : la différence de revenus dans le couple occasionne davantage de gêne auprès des jeunes générations (plus ancrées dans une vision traditionnelle ?), en particulier chez les hommes.
6 . Les femmes sont moins informées mais aussi moins confiantes, plus sujettes aux vulnérabilités
Conséquence d’une relation à l’argent différente, le rapport au risque se révèle particulièrement genré : parce qu’elles l’associent davantage à l’angoisse et parce que leur autonomie financière est moins répandue que chez les hommes (seules 26% des femmes déclarent être la personne au revenu le plus élevé du foyer, contre 73% des hommes), les femmes sont davantage dans une logique de sensibilisation vis-à-vis de leurs enfants : 89% évoquent avec eux la « valeur de l’argent » (+8 points par rapport aux hommes) et 87 % éduquent leurs enfants à sa « gestion » (+5 points).
Les ¾ des hommes comme des femmes épargnent. Néanmoins, les femmes sont plus nombreuses à épargner pour se « protéger des aléas de la vie » (76%, +4 pts). Les hommes épargnent davantage pour leur retraite (33%, +4pts) et, même si cette dimension est largement minoritaire, davantage pour un projet entrepreneurial (7%, +5 pts).Cette vision désincite au risque : seules 16% des femmes se sentent prêtes à prendre des risques pour des investissements contre 29% chez les hommes (13 points d’écart).
L’investissement en bourse reste une pratique masculine : les hommes sont deux fois plus nombreux à investir (23% contre 11%, +12pts), un écart qui se creuse chez les répondants à l’aise financièrement (+19pts) et les moins de 35 ans (+21pts). Davantage sensibles à la « valeur de l’argent », les femmes expliquent le fait qu’elles n’investissent pas par une « peur de l’argent investi » (39%, +8points).
7 . Loin d’être préservé, le couple est un prolongement de la société
Les tensions observées précédemment ne diffèrent nullement de la situation de couple.
La majorité des situations se révèlent équilibrées et d’abord gérées par le couple ensemble, avec une répartition à 50/50 ou équitable des dépenses. Toutefois, quelques éléments n’échappent pas aux constats soulignés plus tôt.
Les opérations et relations avec les professionnels sont encore plus masculines : les échanges avec le conseiller bancaire demeurent encore davantage l’affaire des hommes (46%, +7 points), de même que les placements financiers ou d’épargne (25%, +9 points).
Plus soucieuses des dépenses du quotidien et de la valeur de l’argent face à des aléas auxquelles elles se sentent plus exposées et donc plus vulnérables, près d’un tiers des femmes en couple déclarent avoir déjà essayé de décourager leur conjoint de procéder à une dépense (30%, +5).
Hommes et femmes expriment une opinion relativement homogène des tensions suscitées par les problématiques financières dans leur couple. Toutefois, les moins de 35 ans témoignent d’une sensibilité majeure face à ces tensions. Pour illustration, si 27 % des répondants considèrent qu’une dépense jugée excessive a suscité des tensions au sein de leur couple, ce score s’envole à 50 % chez les hommes et 46 % chez femmes de moins de 35 ans.
Arnaud Zegierman & Adrien Broche
Viavoice